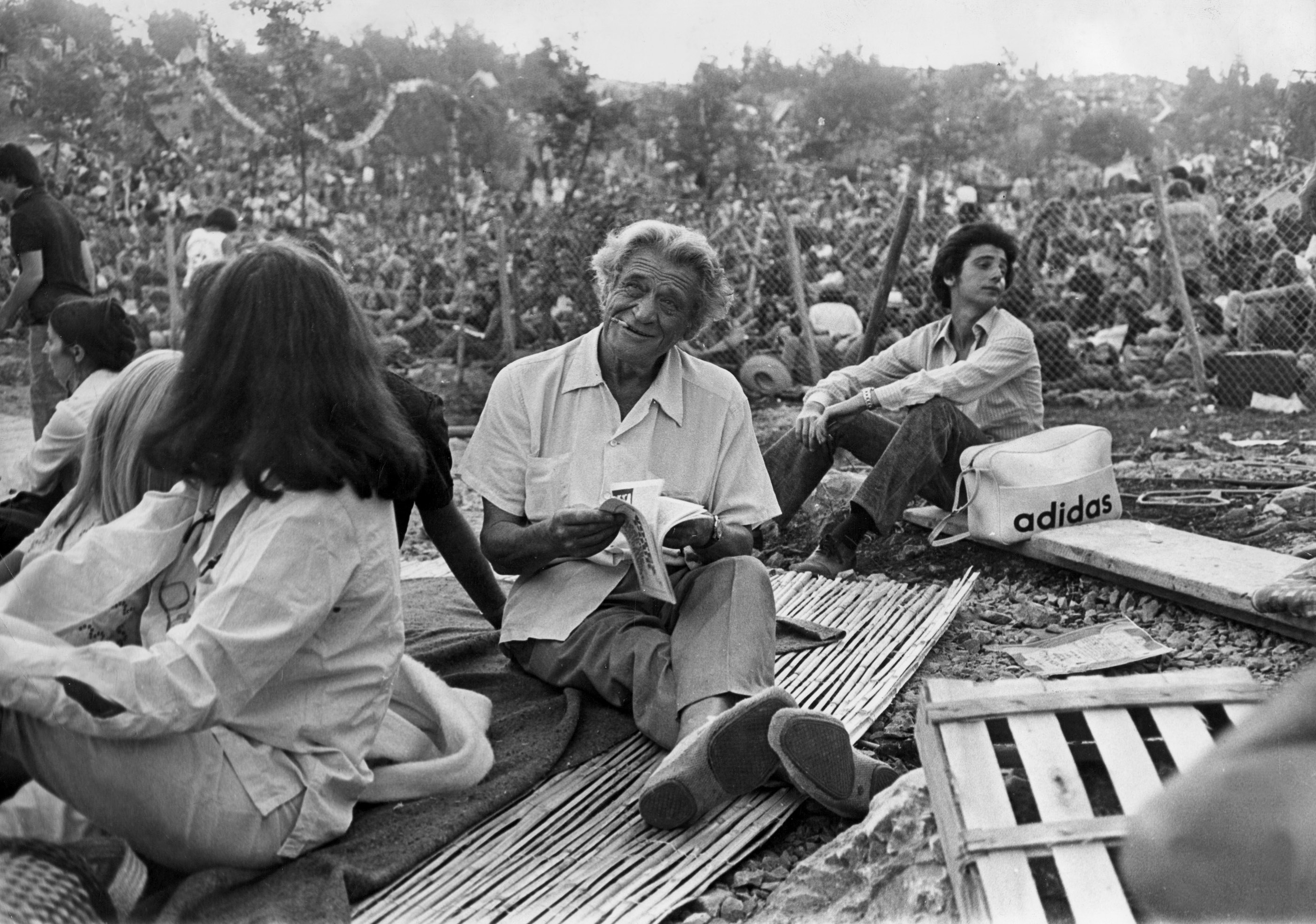Nombre de romanciers aiment fréquenter les fétiches avant de se jeter à corps perdu dans l’écriture. Caresser, admirer l’objet, conjurer le sort puis transpirer jusqu’à l’os. Le fétiche est un aiguillon qui donne du sang puis réchauffe la main. Il est à l’écrivain ce que le fouet est au sadomasochiste. Obsédé par les mots qui tardent à s’expurger, l’auteur verra le Graal au travers d’une statuette, un tableau, un bijou ou un vieux plumier. Le talisman adulé est un faux miroir qui plonge en vous. Pour le meilleur ou pour le pire, l’amulette représente bien souvent l'antichambre de l’inspiration. On aimerait lire un essai sur les rapports étroits qu’entretiennent les écrivains avec leurs objets fétiches. L’histoire de la littérature contemporaine y gagnerait sans doute de nouveaux horizons. Cet attachement compulsif qui fait que l’on trouve l’inspiration, que l’on perd du temps et qui permet le coup de jarret, le démarrage d’une phrase ou la plongée dans le fil de la narration. De la Remington d’Hemingway à l’équerre d’acajou «qui sentait la boîte à cigares» de Colette (parmi d’autres objets), de l’angelot de bronze étranglant un serpent pour Hervé Bazin à la pointe de harpon de baleinier pour Philippe Djian, les exemples ne manquent pas de ces objets-cultes, de ces Rosebud chers à Orson Welles qui font le lit de la création littéraire. En grand superstitieux, Kessel n’échappe pas à cette lignée. Des fétiches, il n’en rapportera pas énormément de ses voyages - «je n’ai jamais eu le goût de faire la chasse à l’objet rare, à l’occasion », confie-t-il à la télévision allemande dans les années 60 - mais conservera quelques précieuses reliques tout au long de sa vie. Cinq objets fétiches principaux l’accompagneront au cours de ses pérégrinations et déménagements.
La malle de cuir est le premier et sans doute le plus important de ces totems tant vénérés. Il s’en défait rarement, même si la peau est défraîchie et raclée. Il y jette quelques vêtements, des livres en russe et en français et nombre d’affres. Boussole de ses passions, elle ne cesse de le narguer lorsqu’il est au repos dans son appartement du 8e arrondissement parisien ou dans sa thébaïde du Val d’Oise. Une valise de voyageur est faite pour être remplie et vite refermée. C’est une lampe de djinn bienveillant qui sait distiller son parfum d’inconnu. Faire sa malle est un geste de sauvetage. Les reporters de guerre y mettent quelques atlas afin de transgresser les frontières, et les écrivains y lancent leurs affres d’hier et les espoirs en feuillets de demain.
Second fétiche, le double cadre de photos. Il contient les portraits de Sandi, sa première épouse, qui n’a pas survécu à la tuberculose et s'est éteinte en Suisse, à Davos, et de son jeune frère Lola. Tandis que Sandi agonisait en sanatorium, lui invitait sa maîtresse dans l’hôtel voisin, manière de braver le destin. Le diptyque ne portait pas les traces de l’infidélité et Joseph Kessel se dédouana en rendant hommage chaque soir à la défunte, de Paris à Nairobi, sous le regard parfois agacé de ses compagnes ou nouvelles épouses. Lola, le jeune et ténébreux comédien, est lui aussi parti très vite, à vingt-et-un, ans, d’une balle en plein cœur. A chaque reportage, dans ses chambres d’hôtels ou dans les trains, Kessel déploiera le porte-photos, en un rituel immuable. Il l’embrasse le matin et la belle défunte se retrouve constamment maculée de traces de café. Chaque fois qu’il quittera son appartement du 8e arrondissement, rue Quentin-Bauchart, ne serait-ce que pour cingler vers sa maison de campagne à Avernes, il portera à ses lèvres les photos des siens, qui composent un singulier autel du souvenir vitré.
Autre objet culte, une statue d’albâtre en provenance des sables de Marib, celle que lui offrirent à Sanaa les Russes et le médecin de la mission soviétique, des bolchéviques qui fermèrent les yeux sur les positions anticommunistes de leur compatriote. On pense aux morceaux de marbre que rapporta Chateaubriand de Rome, lors d’une escapade archéologique fort dispendieuse, «cette loterie des morts». La statuette yéménite représente le visage d’une femme aux traits lisses et au regard évanescent, presqu’absent, une œuvre singulière et mystérieuse à la croisée du style hellénistique et de l’Orient bouddhique, art qui ressemble à s’y méprendre à l’art du Gandhara et aux grandes statues de bouddha à Bamiyan que Kessel découvrira vingt-six ans plus tard, lors de son voyage en Afghanistan avec le jeune cinéaste Pierre Schoendoerffer. L’oeuvre d’art a en fait une curieuse origine. Elle a été extraite des sables de Marib, la ville mythique de la reine de Saba, bien au-delà de montagnes de Sanaa, par des marchands d’art puis revendue à Sanaa. Jef la gardera toujours avec lui. Le faciès intriguant, à la fois pur et tourmenté, demeurera au chevet de Kessel des décennies, comme un résumé des aventures, des barouds et reportages aux quatre coins du monde, là où les visages souvent ne parlent plus. C’est en la contemplant que Malraux aurait eu l’idée d’explorer avec l’aviateur Corniglion-Molinier, quatre ans plus tard, les ruines de Marib au Yémen, une expédition financée par L’Intransigeant et à grands renforts de publicité – sans que l’on soit certain que l’écrivain ait pu apercevoir la cité antique, doutes qu’il rappelle dans ses Antimémoires. La magie d’une grande oeuvre d’art tient aussi à ce qu'elle peut envoyer dans des déserts improbables les chercheurs de vérité, même s'ils ne trouvent rien.
Un quatrième objet fétiche compose ce musée tangible et néanmoins imaginaire, conservatoire des chimères et des attentes insensées de la vie, pour les trésors qu’il cache et révèle à la fois. C’est une cravache de tchopendoz, de cavalier afghan du bouzkachi, présent d’un chef de tribu afghane. Ce jeu royal impressionne fortement Kessel lorsqu’il se rend pour la première fois en Afghanistan. Il gardera auprès de lui cette sorte de knout afghan, par vents et marées, même s’il n’a jamais pu monter sur l’un des chevaux de feu, trop mauvais cavalier. Au-delà de la course équestre, au-delà de la relation virile voire sanguinaire entre les deux équipes, ce qui intéresse l’écrivain est toute l’épopée de ce jeu, sa préparation une année durant, la dévotion des cavaliers pour le tournoi et pour leurs bêtes, plus précieuses que leur propre corps, bref l’aventure humaine qui le sous-tend. Kessel trouve là une certaine poésie, une mélodie des steppes et des montages de l’Hindou Kouch qui le poursuivra toute sa vie, et la cravache symbolisera tous ces élans du cœur et ceux d’un peuple. La cravache qui cingle, symbolise les guerriers, cloue littéralement le bec aux outrecuidants, saigne les visages, déforme les joues, fend la foule, la cravache sera l’un des objets les plus chers de l’écrivain dans ce petit musée portatif, bien qu’il ait toujours préféré user de ses poings.
Enfin le manuscrit de sa mère. Toute sa vie, Kessel aura essayé d’écrire sur Raïssa. Cent fois, le projet littéraire sera repoussé, malgré l'insistance de ses amis, dont Georges Walter et Yves Courrière. Raïssa Kessel était une mère juive de caractère, ce qui est une litote, convenons-en, et attendrie. Elle avait perdu un fils, le plus jeune, Lola, qui avait préféré s’envoyer une balle en plein cœur plutôt que de continuer à vivre à la marge de soi. Elle avait survécu à maints naufrages, aux dangers des traversées atlantiques lorsqu’elle avait migré en Argentine puis en Russie, à la guerre, aux rafles. Un livre sur sa mère, Kessel y croyait. Cela lui brûlait même les doigts et l’âme. Le sentiment d’amour envers sa mère était infini, bien qu’il la tançait parfois, bravache de fils adulé ou d’écrivain aviné. Pendant la guerre, il lui trouve une cache à Toulon puis dans le Vaucluse, sous le naïf pseudonyme de Qayselle, destiné à tromper l’ennemi. Malgré les encouragements, il n’a eu de cesse de remettre le dessein du livre à plus tard, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de mourir surtout. Aidé par l’écrivain Michel Le Bris qui l’accueillit dans sa thébaïde bretonne de Morlaix, Georges Walter s’attela à l’ouvrage après la mort de son ami, en 1979. Il en ressortit une somme émouvante, Le livre interdit. Walter acheva ce que Jef ne put accomplir. Lorsqu’il apposa le mot fin, il expira. Une sortie à la Molière. Kessel, lui, avait demandé à sa mère en guise de compensation de raconter ses mémoires, dans un texte dactylographié, parade de superstitieux. Le manuscrit n’est pas dénué de talent, bien au contraire. Raïssa était une femme courageuse et aimante, rebelle à toute barbarie et profondément humaine. Ces pages érigées en trésor fétiche ont servi de prétexte au fils pour ne pas écrire lui-même sur l’amour maternel, dans la veine d’Albert Cohen. Sans doute a-t-il appréhendé l’ampleur de la tâche. «Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais, écrit Romain Gary, admirateur de Kessel, dans La promesse de l’aube. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances.» Jef a évité de manger froid et a continué de serrer les femmes contre son cœur à défaut d’un manuscrit. Sa libido a été préservée. Mais la littérature aurait sans nul doute gagné à ce qu’il laissât tomber le manuscrit fétiche pour écrire le livre maudit et chéri à la fois de sa propre main.
Aventure. Les aventuriers ont toujours été à la fois sublimés et détestés. L’aventure est pourtant la conséquence du rêve individuel et l'antichambre de l’espoir collectif. Elle est un antidestin. Elle est aussi le ferment du roman moderne, depuis les péripéties de Don Quichotte. Comme si la somme des ordinaires se cristallisait souvent dans le cheminement d’un seul, qui incarne la découverte, l’exploration, autant géographique qu’humaine, la cristallisation du danger et le désir nomade que toute société devenue sédentaire porte au plus profond d’elle-même. Auréolée de prouesses, abîmée par maintes errances, sublimée par une certaine littérature, l’aventure est devenue ainsi une valeur fondamentale de l’homme moderne. Ces romanciers de l’aventure et aventuriers romanesques m’ont fait rêver, ont peuplé mon imaginaire, ouvert des horizons lorsqu’il était trop fermé. Une aventure du dedans davantage que celle du grand dehors. Les errances de l’âme de ces héros et galopeurs de frontières m’ont donné des ailes bien davantage que la description de leur décor – prétexte révélateur pour les plus grands romanciers, de Conrad à London, de Stevenson à Kipling, de Hemingway à Malaparte. L’aventure est la continuation de l’existence par d’autres moyens.
Pour Kessel, comme pour nombre de romanciers, pas d’écriture sans aventure. Il pressent qu’une vie vagabonde va nourrir une œuvre. Et il désire avant tout faire de sa vie un poème en actes, dans la tradition de l’aventure littéraire. «Aimant surtout l'imprévu et l'aventure, j'espère que la vie m'en fournira d'ici peu et me donnera ainsi une nouvelle nourriture littéraire», estime-t-il dans une lettre en juillet 1924. La dérive du dehors permet la plongée du dedans, et les décors servent de tremplin au voyage intérieur, avec les horizons de l'âme sans cesse repoussés par les étendues des confins et les miroitements de l’inconnu. L’éloignement comme alibi, le décentrement comme matrice à explorer les tréfonds de l’âme. Le voyage dès lors est aussi et d’abord une plongée dans le sentiment et le remords. Un parfum de Conrad, toujours. Et le testament de Jack London, qu’il soit véridique ou non: «J'aime mieux être un météore superbe plutôt qu'une planète endormie.» Le goût de l’aventure inonde ainsi les pages des romans et essais de Kessel. «A moi venaient les mers de Chine, l’océan Indien, la mer Rouge et toutes leurs escales.» Quelle magnifique invitation au voyage qui clôt Les temps sauvages! Lui-même ne pouvait envisager sa vie sous un autre sceau que celui du baroud, cette bagarre avec soi-même. Accomplir dans l’action un destin personnel et d’exception. Les aventuriers mythiques le fascinent, de Jack London à Conrad, ceux des temps modernes aussi, Mermoz d’abord, pionnier de l’aviation, Monfreid ensuite, malgré ses trafics divers et variés, quelques guerriers enfin, pilotes de guerre reconvertis en as de l’Aéropostale. Des gens d’errance et amateurs des confins qu’il a toujours cherché à rencontrer. En retour, il en récolte une preuve de fraternité, «cette étrange confiance que, dans tous les pays du monde, m’ont témoignée les hommes d’aventure – les pires comme les meilleurs» (Tous n'étaient pas des anges). «Une grande joie nous soulevait. Nous abordions l’aventure», écrit-il encore en un souffle souverain dans Marchés d’esclaves, l’un des grands reportages de sa vie. La guerre lui fournit aussi un parfum d’aventure, comme pour nombre de reporters ou correspondants de conflits. Il est fasciné par certains chefs de guerre, aventuriers dans l’âme et autant de pères-courage, tel le lieutenant Collet, officier méhariste français dans le désert syrien, arabisant, fin, intelligent, qui fanatise ses hommes par sa bravoure, sa droiture et sa soif de l’aventure. Parfois, par courage ou inconscience, nul ne le saura jamais, pas même lui, il charge à la tête de ses hommes sans arme, en brandissant une simple cravache! Cet officier du désert comme on en fait peu adore ses combattants et l’inverse est vrai. Chacun de ses Tcherkesses vaut à ses yeux un escadron. Sa réputation s'étend dans tout le Levant. «D’Alep à la Côte, du Djebel Druse au Djebel-Zahvié, de Damas à Beyrouth, nul n’est plus célèbre, nul n’est plus craint et aimé que lui» (Témoin parmi les hommes). Lorsqu’il parle, c’est une chanson de geste qui sourd de ses lèvres. Il fanatise ses hommes, qui admirent son courage et son goût de l’aventure. C’est un sabreur hors pair avec lequel on ne plaisante pas, qui charge toujours en tête de ses cavaliers. Un personnage de roman comme les aime Kessel et qui lui inspirera plusieurs de ses personnages. Il retrouve en lui l’exaltation, la passion, le goût de l'aventure et le frisson du danger qui lui plaisent tant et qui lui font aimer la vie, quitte à plonger dans les pires excès.